Memento des activités 2022 de l’ACF


Chers participants,
Du nouveau sur Lacan Web Television : l’émission STUDIO LACAN !
De quoi s’agit-il ?
Chaque samedi à 21h30 précises (heure Réunion), deux psychanalystes de l’École de la Cause freudienne reçoivent trois invités pour analyser, débattre et discuter du malaise dans la civilisation, autour de trois rubriques : un divan dans le monde, l’écho de la culture et actualité de la psychanalyse.
Le format du « direct », rythmé par le jeu des questions/réponses, donne à ces émissions un style très dynamique et très vivifiant !
Pour en savoir plus, découvrez vite la vidéo de présentation de cette émission en cliquant sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=PNKiUule7Ms
A très bientôt sur Lacan Web Television, la chaine Youtube de l’École de la Cause freudienne !
Michèle Chalmin-Joufflineau, référente de la e-commission nationale à la Réunion
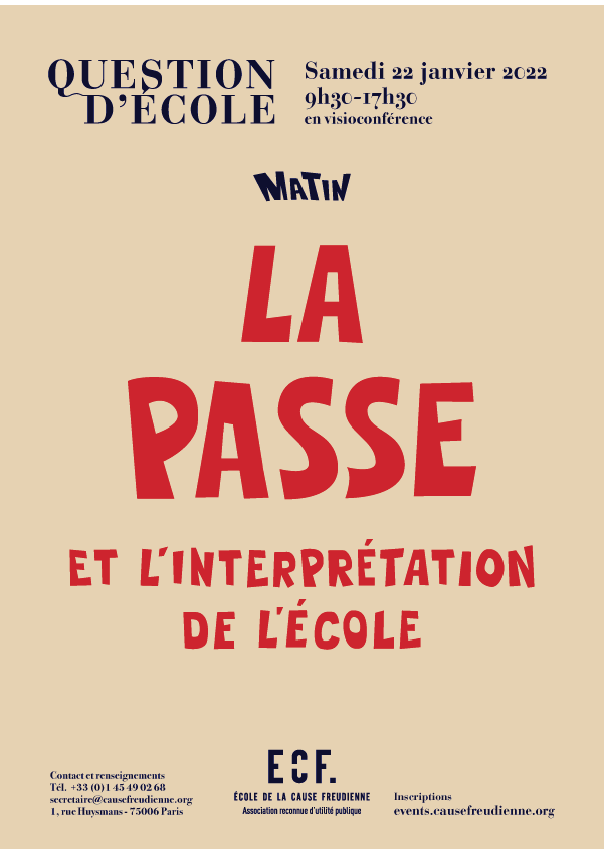
Chers participants,
Cette année, Question d’École abordera deux thèmes distincts, mais pas sans rapport.
Le matin se tiendra sous le titre « La passe et l’interprétation de l’École » et sera l’occasion d’un retour du collège de la passe. L’après-midi nous mobilisera autour d’un dit de Lacan, « Tout le monde est fou », afin d’explorer la dépathologisation de la clinique. La folie, entre semblant et réel, se lit sur fond d’une « psychanalyse liquide » que Jacques-Alain Miller introduit dans son cours de l’Orientation lacanienne « Tout le monde est fou » en 2008. Dès lors, une question commune au matin et à l’après-midi se dessine : que deviennent alors les solides de la structure ?
Téléchargez l’argument, l’affiche de la matinée et l’affiche de l’après-midi.
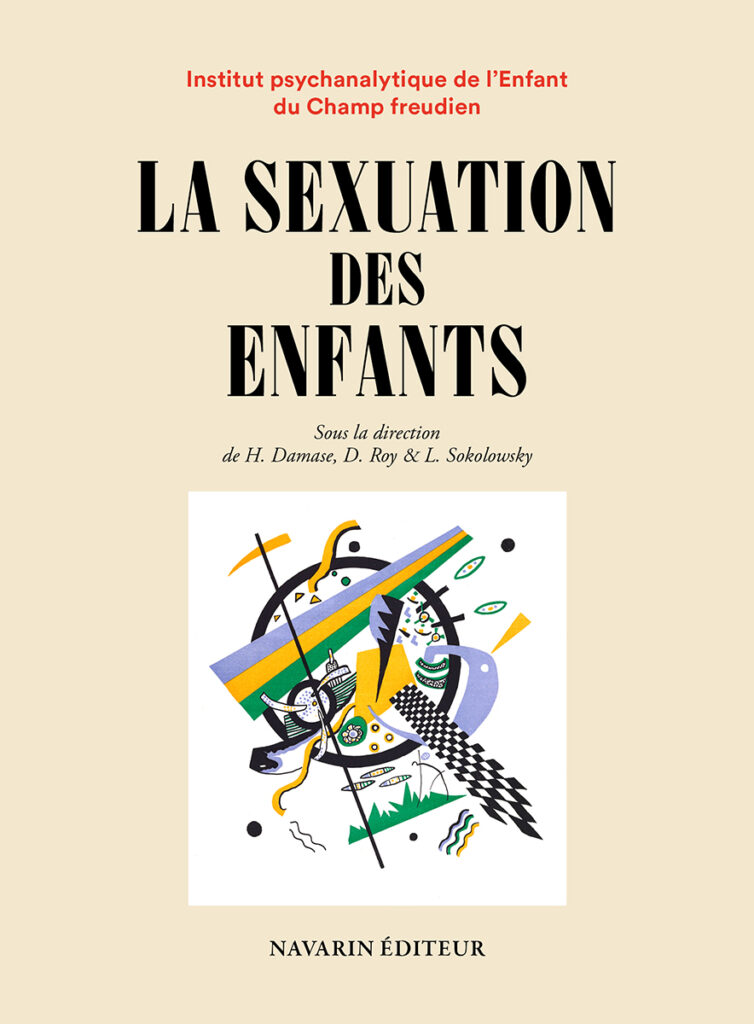
Chers collègues,
L’Institut psychanalytique de l’Enfant et Navarin éditeur ont le plaisir de vous annoncer la parution d’un nouvel ouvrage :
La Sexuation des enfants
sous la direction de Hervé Damase, Daniel Roy & Laura Sokolowsky,
Travaux de l’Institut psychanalytique de l’Enfant du Champ freudien
Sur le thème de sa 6e journée, l’IE a réuni un ensemble de textes qui éclairent cette question brûlante de notre époque.
Cet ouvrage paraitra en librairie le 16 novembre 2021 et est disponible sur ecf-echoppe.com.
Vous pouvez d’ores et déjà en découvrir sa présentation en cliquant ICI ainsi que son sommaire en cliquant ICI.
Bonne lecture!
Pour l’équipe du site,
Michèle Chalmin-Joufflineau.
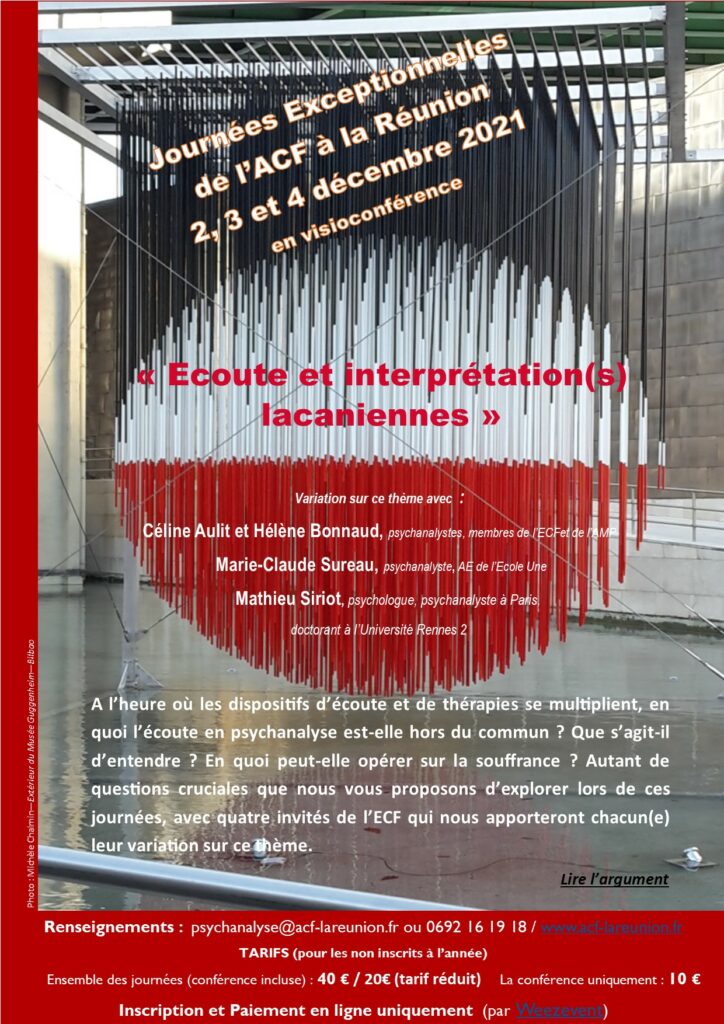
Cher(e)s collègues,
L’ACF à la Réunion organise des Journées exceptionnelles sur le thème :
« Écoute et interprétation(s) lacaniennes »
Elles auront lieu les 2, 3 et 4 décembre 2021, en visio-conférence.
Pour découvrir l’argument et procéder à votre l’inscription en ligne, cliquez sur les liens de l’affiche intéractive ci-dessus.
Au programme, nous vous proposons :
Jeudi 2 décembre, 15h-18h30 : Atelier de lecture et atelier clinique avec Céline Aulit,
Vendredi 3 décembre, 13h-15h15 : Atelier Latulu sur La Cause du Désir n°108 « Pas d’écoute sans interprétation » avec Hélène Bonnaud,
Vendredi 3 décembre, 18h30-20h30 : Conférence clinique prononcée par Mathieu Siriot
Samedi 4 décembre, 13h30-16h : Témoignage de Passe de Marie-Claude Sureau
Ne manquez pas cet évènement sur un thème crucial et d’actualité, qui clôturera notre année de travail et ouvrira sur l’année prochaine !
Il est nécessaire de vous inscrire, même si vous êtes inscrits à l’année aux activités de l’ACF, avec le lien ci-dessous :
https://my.weezevent.com/journees-exceptionnelles-de-lacf-a-la-reunion
Il est possible de s’inscrire à l’ensemble des journées, ou uniquement à la conférence de Mathieu Siriot.
Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez les liens de connexion la veille et 2h avant les journées. Pensez à vérifier dans vos spams !
Pour l’équipe du site,
Michèle Chalmin-Joufflineau

Cher.e.s collègues,
La prochaine séquence du Séminaire d’Introduction à la Psychanalyse aura lieu
:
Lundi 6 décembre 2021, de 18h30 à 20h30En présentiel, à l’hôtel Alamanda, l’Hermitage
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites à l’année et qui s’inscrivent à la séquence,vous êtes invités à effectuer votre inscription et le paiement avec le lien weezevent ici: https://my.weezevent.com/seminaire-dintroduction-a-la-psychanalyse-3
N’hésitez pas à contacter le bureau si besoin à propos de cette reprise du présentiel.
Bien cordialement,

« Désir et Lire »
Écho à « Désirer lire », thème d’une matinée de travail de l’ACF avec Bénédicte Jullien – Août 2021
« Écrire sur quelque chose qui est presque aussi vital pour moi que de respirer », c’est à peu près ce que j’ai répondu à la collègue qui m’a sollicitée pour cette séquence. Puis, à la lecture de son mail, sitôt lue la formule « désirer lire », celle-ci s’est mise à résonner comme « désir-et-lire », tant la langue toujours se plaît à l’équivoque, de celle, ici, qui réveille dans sa dimension d’énigme. Car oui je lis mais je ne m’étais jamais posée la question de savoir si lire procédait d’un désirer-lire, j’ai envie de dire « je lis comme je respire ». Or le dire ainsi, serait situer le lire du côté d’une « propriété du corps vivant », c’est une formule de Lacan, qui précise « mais nous ne savons pas ce que c’est que d’être vivant sinon seulement ceci, qu’un corps cela se jouit. » (Sém. XX p. 26). Se pourrait-il, ce corps, le mien corps, qu’il se jouît tant soit peu par les voies / voix du lire ? Équivoque à nouveau, car oui, à lire, il y a possiblement une présence de la voix en tant qu’elle véhicule la « motérialité » du signifiant. C’est spécialement perceptible dans la poésie, propre à mon sens, à rendre compte de l’affirmation de Lacan : « l’écrit n’est pas à lire », qui ouvre sur deux questions : qu’est-ce que l’écrit et qu’est-ce que lire ?
Comment rendre sensible cette double valence désir-jouissance qui parcourt pour moi ce qui touche au lire ?
Je saisis le « lire » de la formule « désirer lire » comme un objet convoité en tant qu’il vise une satisfaction. C’est là une modalité du désir dont j’ai à l’occasion un vécu. Fondamental est celui, dans ma petite enfance, de mon obstination à vouloir lire moi-même un livre que je savais par cœur, comme tout enfant qui inlassablement se fait lire et relire l’histoire qu’il prise. Il s’appelait « Le petit remorqueur » et je cherchais à retrouver dans les lettres imprimées les mots entendus de la voix qui les lisait. C’était alors un désir de savoir lire, à entendre ici dans sa dimension de déchiffrage, une opération éminemment solitaire, qui n’a jamais cessé de m’occuper. Il y de cela aussi dans la lecture de Lacan, dont les écrits, comme nuls autres, font « cor-pousse » à l’interprétation.
Or si ce petit livre a pu cristalliser un désir de lire, c’est sans doute parce que circulait pour moi, dans les pérégrinations de ce petit remorqueur, une charge de jouissance singulière, non dénuée d’une certaine souffrance. A la suite d’un déménagement à l’âge de 4 ans et demi, j’ai cherché longtemps « mon petit remorqueur », définitivement perdu. Introuvable aussi un livre qu’à un moment de ma vie, j’ai désiré re-lire, sans qu’aucunement je ne sache pourquoi. Aujourd’hui je ne peux que me demander quel objet caché pouvait bien en son temps receler ce désir là ? Car désirer lire peut être désirer… lire une certaine chose mais de cette chose, qu’en est-il ?
Quant au désirer-lire absolu, qui ne viserait aucun objet repérable, j’en fis l’expérience lors de courtes vacances en Tunisie, où, étrangement, je débarquai sans rien à lire. J’en éprouvai un réel mal-être et je me surpris à déchiffrer tout ce qui de lisible tombait sous mon regard comme autant d’oculus ouverts dans le foisonnement de l’écriture arabe, par exemple tout ce qui se trouvait écrit sur la boîte du déjeuner chocolaté, ce pourquoi je parle de déchiffrer et non de lire. Mue par le manque, je trouvai d’un pas sûr le chemin d’une bibliothèque et de livres en français.
Exception faite des publications en ligne, telles nos « hebdo-blog, Lacan Quotidien, Ironik », et autres, le désir de lire reste associé pour moi à ces objets matériels que sont les livres, les journaux, les revues.
A l’époque d’avant Google et Wiki, j’ai beaucoup fréquenté les bibliothèques, ces lieux où se conjuguent désir de lire et désir de savoir, j’y arrivais avec mes petits carnets pour pouvoir questionner les petites fiches bristol si bien rangées dans leurs casiers à tiroirs. Quand la bibliothèque était à 40 km, le corps étant impliqué dans l’aventure, il y fallait sans doute bien du désir.
« Désir et Lire », en trois mots, m’évoque un sujet occupé à lire, pris dans un lire qui aurait à voir avec l’objet cause, autant qu’avec plaisir et jouissance. C’est ma mère disant ne pas pouvoir s’endormir sans avoir lu un chapitre de son roman en cours, et se plaignant de ne pouvoir le faire toujours qu’après minuit. C’est, dans un tressaut de rire, un lire comme à la sauvette, celui de mon père accroupi au-dessus d’un journal étalé au sol, avec son drôle de nom : « Le hérisson, Le canard enchaîné, Harakiri ». C’est un grand-père ouvrant de gros livres en présence de ses gendres pour leur parler de sa guerre. C’est une grand-mère déplorant d’avoir encore une fois acheté un livre qu’elle ne comprenait pas parce qu’elle n’avait pas eu « la chance d’aller à l’école ». Ce sont, sur un flokati, mes enfants tout petits, m’écoutant lire de la poésie.
C’est le discours de l’école dite élémentaire, assez portée à ignorer le désir, et à coincer le lire entre injonction et interdit.
Mais c’est aussi notre École, celle de la Cause freudienne, c’est Lacan me tirant du lit en pleine nuit car je viens de retrouver où relire le passage dont le manque m’a taraudée toute la soirée. Lacan dont j’ai toujours trois ou quatre séminaires ouverts en même temps, plus un au moins qui se lit en cartel, séminaires vigoureusement « transcris », selon son propre mot, par JAM, qui nous les rend lisibles, et que je lis toujours dans l’articulation avec l’Ecrit correspondant. Le Séminaire donc se lit tandis que de l’Écrit, je tente de déchiffrer quelque chose, m’agaçant parfois de cette écriture tordue ou en savourant le style, la précision, l’équivoque délicieuse, l’aporie énigmatique, la connivence de l’ellipse, l’allusion érudite, l’absolue pertinence d’une formule géniale. Il y a cette jouissance de la lecture solitaire, mais aussi, sous les formes diverses que nous offre l’École, la joie du travail à plusieurs, où le lire pousse au dire et au dire mieux, à l’écrire, et qui se nourrit de toute la littérature qui s’y produit de façon incessante. Il y a plus spécifiquement, le lire depuis sa place dans un cartel, où se frottent les interprétations, comme des silex pour en faire jaillir l’étincelle.
En termes d’appartenance d’École, une nécessité vibre au joint où s’acoquinent désir de lire et désir de l’analyste.

« Une vraie femme, c’est toujours Médée[1] »
Texte présenté lors de la séance de l’Atelier de lecture de l’ACF à la Réunion- Avril 2021
C’est à la fin de son texte « Mèrefemme[2] » que Jacques-Alain Miller fait référence à la figure de Médée. Il dit ceci : « […] Médée, c’est le mémento qu’il faut pour faire se souvenir à l’homme endormi […] que la féminité ne s’éteint pas dans la maternité. Ce pauvre con de Jason croyait que sa femme l’aimait comme une mère ![3]»
C’est en prenant pour exemple cette figure de la mythologie grecque qu’il va écrire dans « Médée à mi-dire », cette phrase : « Une vraie femme, c’est toujours Médée ». C’est Lacan qui, le premier, introduit cette notion de « vraie femme[4] ».
Mais alors, qu’est-ce qu’une « vraie femme » ? D’un point de vue analytique, nous dit J.-A. Miller, « une vraie femme n’est pas la mère[5] ».
Soit ! La mère c’est celle qui a, c’est l’Autre de la demande, c’est l’abondance. En revanche, une « vraie femme », telle que Lacan en fait miroiter l’existence éventuelle, c’est celle qui n’a pas, c’est l’Autre du désir, c’est celle qui, « de ce « n’avoir pas », fait quelque chose[6] ».
Alors en quoi Médée illustrerait-elle « une vraie femme » ?
Le mythe de Médée, version courte !
Médée est la fille du roi de Colchidie qui détient la Toison d’Or. Elle est donc à la fois d’ascendance royale mais possède également de nombreux pouvoirs magiques qui font d’elle en quelque sorte une sorcière.
Lors de la venue des Argonautes en Colchidie, qui sont à la recherche de la Toison d’Or, elle tombe éperdument amoureuse de Jason. On parlerait aujourd’hui de coup de foudre : elle le voit, elle l’aime et elle le veut ! Médée, par amour pour Jason, est alors prête à tout pour l’aider dans cette conquête, quitte à trahir son père. Une fois la Toison d’or en leur possession, Médée s’enfuit alors avec Jason, non sans assassiner et dépecer au passage son propre frère !
Revenus en Thessalie, le roi Pélias refuse le trône à Jason malgré sa réussite dans la quête de la Toison d’Or. Usant de ses pouvoirs magiques, Médée parviendra à le faire assassiner puis manger par ses propres filles !
Médée et Jason se réfugient ensuite à Corinthe où ils auront deux enfants. Au bout de quelques années, Jason répudie Médée pour épouser Glaucé, la fille du roi.
Comment Médée réagit à ce laisser-tomber de Jason ?
Médée aurait pu tuer Jason, ce qu’il redoute quand il s’aperçoit que Médée est passablement contrariée qu’il l’ait trompée. Or ce n’est pas ce qu’elle va faire. Elle va opérer autrement : elle va sacrifier, tuer les deux enfants qu’elle a eus de Jason.
En agissant ainsi, elle s’en prend à ce qu’il a de plus précieux, sa descendance en tant que ses enfants l’inscrivent dans la chaîne symbolique de la filiation, de la transmission à partir du nom. Est-ce qu’on peut dire que quand Médée tue ses enfants, ce n’est pas l’acte de la mère ? Car ses enfants elle les aime, « […] mais pas au prix de consentir à n’être que leur mère, déchue de la place qu’elle tenait du désir de l’homme qui est le sien. L’acte féminin […] est d’arracher le plus précieux, l’agalma[7]. »
Par vengeance, Médée vient ébranler le nom de Jason, ce qui pourrait lui succéder, en quelque sorte son avenir. D’ailleurs, elle ne s’arrête pas là : elle tue aussi l’amante de Jason, le privant encore de toute descendance possible. J.-A. Miller le formule ainsi : « Du même coup, elle frappe l’homme dans sa béance. Son acte, en effet, n’est pas le soin ; son acte n’est pas de nourrir l’homme, ni de le protéger, c’est de le frapper ; sa menace, de pouvoir toujours le faire[8].»
Et Médée ne s’arrête pas là !
D’abord quand Jason lui demande de lui rendre les corps de ses enfants pour les enterrer, elle refuse et les emmène avec elle sur un char, le privant ainsi de sépulture où son nom aurait pu figurer. Ensuite, en tuant l’amante de Jason, le privant ainsi de la possibilité qu’elle lui donne des enfants à son tour.
Donc, certes elle lui laisse la vie sauve mais lui « pourrit » son avenir. Chez Médée, on peut dire que la vengeance se situe sur le versant de la haine (envers de l’amour) et vise le sujet et pas la personne.
Médée : logique du tout versus logique du pas tout ?
On peut dire qu’en tant que mère, Médée répond à la logique phallique : elle donne des enfants à Jason, il est père, elle est mère, c’est la logique de la descendance, de la succession, de la filiation. C’est une logique du tout.
Mais ce qu’on constate, c’est que bien qu’elle semble prise dans cette logique phallique, elle ne recule pas à sacrifier « ses objets phalliques[9] », ses enfants, ce qui la faisait mère donc, quand Jason la « laisse tomber ». Une fois la « mère drainée », il semble qu’il reste une femme, une femme certes haineuse dans le cas de Médée !
« Une vraie femme », dit J.-A. Miller, « c’est le sujet quand il n’a rien – rien à perdre. Une vraie femme, à la mode de Lacan, ne recule devant rien, devant aucun sacrifice, quand le plus précieux est en jeu – devant rien, là où l’homme, obnubilé, empêtré par ce que lui a à perdre, ne s’avance pas, détourne le regard, passe à autre chose. Et c’est ce qui faisait dire à Freud : les femmes n’ont pas de surmoi[10]. »
Il semble que pour Médée, comme le dit J.-A. Miller, « les enfants n’aient pas si bien leurré en elle le désir d’être le phallus[11] ».
Donc, au sein d’une même femme, Médée, apparaît « […] un fonctionnement qui dissocie une logique universaliste qui l’inscrit dans le registre des lois humaines (celles du père et de la transmission), et une logique d’un autre ordre, qui, dans cet exemple-là, est à la fois la logique de l’amour et de la haine – l’amour versus la haine[12]. » C’est parce qu’elle aime Jason qu’elle agit ainsi, c’est donc une logique de l’amour, une logique du registre du pas-tout, qui signe l’absence d’universalité du féminin.
Pour conclure
Je reprendrai les propos de J.-A. Miller : « Médée ne voulait pas être mère sans être en même temps l’Autre femme. Il peut arriver qu’une maternité éteigne chez une femme la féminité. Cela se rencontre. Mais que la mère reste toujours femme, un homme ne l’oublie qu’à ses risques et périls[13]. »
[1] Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n°89, 2015, pp. 113-114.
[2] Miller J.-A., « Mèrefemme », La Cause du désir, n°89, 2015, pp. 115-122.
[3] Ibid., p. 122.
[4] Jacques Lacan emploie cette expression à la page 761 de « Jeunesse de Gide, ou la lettre et le désir » (Écrits, Paris, Seuil, 1966).
[5] Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 113.
[6] Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 113.
[7] Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 114.
[8] Ibid.
[9] Brousse M.-H., « Qu’est-ce qu’une femme ? », Le Pont freudien, conférence prononcée au Canada en avril 2000, disponible sur internet.
[10] Miller J.-A., « Médée à mi-dire », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 114.
[11] Miller J.-A., « Mèrefemme », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 122.
[12] Brousse M.-H., « Qu’est-ce qu’une femme ? », Le Pont freudien, conférence prononcée au Canada en avril 2000, disponible sur internet.
[13] Miller J.-A., « Mèrefemme », La Cause du désir, n°89, 2015, p. 122.

Ça commence par c’est…
Atelier de lecture avec Claudine Valette-Damase – Juin 2021
Nous sommes coupés de notre corps instinctuel du fait du langage. Nous l’avions abordé dans le premier atelier de lecture à propos de l’instinct maternel qu’il n’y a pas.
Dès la naissance et en anténatal, l’enfant est vu à partir du sexe anatomique. Ça commence par un : c’est un garçon, c’est une fille. « Lorsque l’enfant paraît, la langue opère une coupure avec l’anatomie » souligne Claudine Valette Damase dans un article « C’est une fille[1] », écrit à propos du livre Fille[2] de Camille Laurens. « Des paroles qui percutent[3] », nous dit-elle. Puis elle ajoute : « être fille ou être garçon ne va pas de soi, c’est une question à laquelle chaque génération répond à sa façon[4]».
Le roman autobiographique de Camille Laurens dans lequel quatre générations de femme se succèdent, se passe dans les années 60, dans une famille où, tous, attendent un garçon.
La nomination par l’Autre est prise dans son désir : à l’annonce de son sexe anatomique, la mère pense « c’est raté » et le champagne n’est pas sorti. Le père, lui, ne se souvient plus du prénom pour la déclaration de naissance à la mairie et finalement, il la prénomme Laurence en hommage à Laurence Oliver. L’auteure voit dans l’étymologie latine de son prénom, laurus, laurier, un insigne que son père ajoute pour conjurer la « née-sans ». Puis, en se choisissant « Barraqué » comme patronyme dans son roman, elle redouble la masculinité désirée. La grand-mère, quant à elle, apprend par le prénom l’arrivée de sa petite fille et associe immédiatement Laurence à « l’eau rance » !
La question du corps sexué ne se résout pas par la nomination : « La difficulté du corps se rencontre comme corps image, biologique, anatomique et un corps que l’on éprouve et l’éprouvé du corps se fait à partir du langage[5] », nous rappelle Bénédicte Jullien. Lacan indique « L’être sexué ne s’autorise que de lui-même… et de quelques autres[6] ». Cela évoque ce qu’il a écrit deux ans plutôt à propos du psychanalyste.
La question, celle de l’être sexué, « qui s’autorise de lui-même », se pose pour chacun ; le sexuel du corps ne dit rien du genre, ce que le « questionnement trans » met en évidence car il ne s’agit pas uniquement d’un questionnement qui concerne les trans. Pour chacun, il peut y avoir quelque fois un écart entre la nomination, l’identification et l’éprouvé du corps. « S’autoriser de soi-même » veut dire qu’il n’y a pas de garantie, pas de garantie de soi-même par un Autre ; ainsi chacun a à inventer sa façon d’être un homme ou une femme…. et « de quelques autres » signifie dans le lien social.
L’éprouver, éprouver son corps, serait le rapport que chacun, chaque LOM, a à son mode de jouir ?
Dans le livre « Fille », comment qualifier l’usage que Laurence a de ce signifiant « fille » ? Signe du désir de l’Autre, chemin où « surgit une pierre de parole qui tient au sexe[7] » ?
Au fur et à mesure du travail d’écriture, ce signifiant qu’elle fait se dégonfler, se décale. Elle entend les paroles de sa fille « c’est merveilleux une fille[8] ». Le merveilleux n’est pas parce que c’est merveilleux, pris du côté du sens, mais parce que ça met un écart entre c’est et une fille.
Ça commence par c’est…Quelque chose de nouveau commence alors pour elle.
Un garçon, une fille c’est aussi l’universel, la norme mâle.
[1] Valette-Damase C., « C’est une fille », in Le zappeur, newsletter du blog des 6èmes journées de l’Institut Psychanalytique de l’Enfant, « La sexuation de l’enfant », mars 2021.
[2] Laurence C., Fille, Paris, Editions Gallimard, 2020.
[3] Valette-Damase C., « C’est une fille », in Le zappeur, Institut Psychanalytique de l’Enfant, la sexuation de l’enfant, mars 2021
[4] Ibid.
[5] Jullien B., « Le transgenre : entre fluidité et binarisme », Lacan Web Télévision, 2021.
[6] Lacan, J., Le Séminaire, livre XXI, Les non-dupes errent, leçon du 9 avril 1974, inédit.
[7] Miller J.-A, L’os d’une cure, Paris, Navarin Éditeur, 2018, p. 20.
[8] Laurence C., Fille, Paris, Editions Gallimard, 2020, p ?
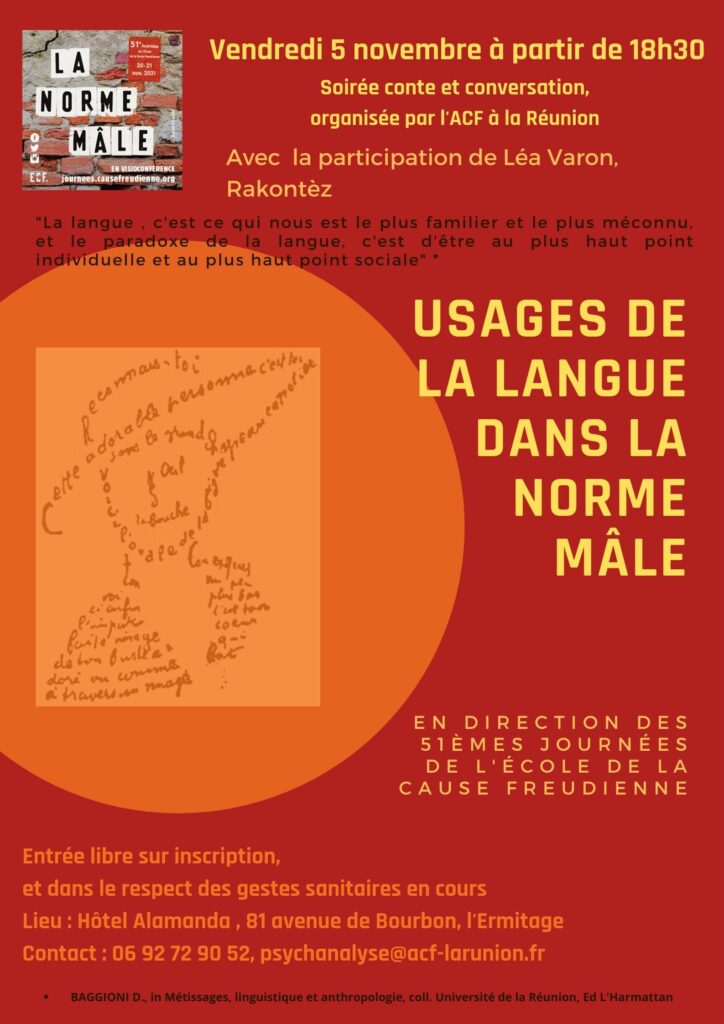
Vendredi 5 novembre 2021 à partir de 18h30
Hôtel Alamanda – St Gilles les bains
Découvrez vite l’argument de cette soirée en cliquant ICI.
Entrée libre et gratuite, sur inscription et dans le respect des règles sanitaires en vigueur liées à la Covid 19.
Nous vous attendons nombreux!
Bien à vous,
Pour l’équipe du site,
Michèle Chalmin-Joufflineau